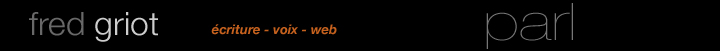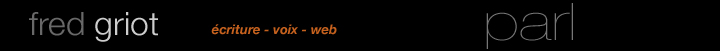1993/2002 - quelques extraits ici...

• acheter le livre sur publie.net - édition 2008
• et quelques pages sur remue.net [cahier de création été 2002]
JE REPRENDS RÉPÈTE RESSASSE... jusqu'à l'inaudible incontinuable noir. Mais je me sens passé déjà.
Je descends calme au fond, je ne pense plus. Je pénètre doucement, doucement m'enfonce dans mon ombre seul. Je suis dans mes veines calme enfin concentré.
J'ai des trous. Mon âge. A m'en souvenir.
J'ai la mémoire du trou.
Je me fais des voix.
Les choses... les choses que je vois... je les laisse... les laisse dans leur matière... Les choses en soi se suffisent. Saisissant leur évidence, je me sens en paix.
Alors je pelote... retrouve en moi, fluide... tout aussi fluide, ma veine. Ma veine tiède écoulante, ma veine inachevable, inachevable parce que la personnalité demeure vivace.
Mon fluant utilisé, mes deux trois notes seulement, jusqu'à ne plus parler, peut-être...
Mon patois. Mon patois. Qu'aurait dit toute sa langue. S'il le fallait encore, oui, se mettre un point inaccessible pour tenir...
Une exigence pour se tenir enraciné, œuvrable... l'orgueil d'être, l'orgueil de devoir œuvrer pour être. L'imbécillité de la liberté...
Où elle est la langue que je me cherchais, qui m'aurait enracinée, qu'aurait dit toute ma musique ?
C'est sûr dans ma pièce froide je finirai... dans mon trou d'froide campagne... trouver la paix la paix doucement... le calme enfin lourd des participants... sur le carrelage froid de ma cuisine...
Dans cette campagne de neige l'hiver. Une cuisine froide, carreaux de terre. Une maison vaste et brute. Dôme tendus des collines. Forêts humides, boues gelées, chemins et pierres dans la glace.
Maison grande, les pièces nues, ma pièce fournie de tables épaisses, jamais époussetées, peu à peu comme dehors. Froide et calme.
Entassée de papiers, tout un monde, mille sentiers où je me tourne.
Ma pièce : 4 mètres de large pour 7 de long et j'ai tout là. Le mur blanc devant, le trou de la fenêtre et quelques trucs accrochés, le rectangle de la porte et le mur de droite plus petit. Et béant sur le trou, ma table.
C'est donc là que je pousse. Ma chaise usée, ma table crasseuse, mais dans mon dégouttoir tout mon confort.
Si je reste assis je peux parfois trouver dans mes fonds des joliesses, des paysages, des motifs. De gras mots vivants, très peu dressés, résistants, galopant vite et montant bien à l'oreille.
Restant assis des heures je vois finalement les choses du fond, et je les sors...
Mais je peux être debout, entre les quatre murs, éructant, m'ennuyant, être très peu voyant. Mais si un visiteur entrait il ne verrait rien de changeant car tout est si lent.
Peu à peu, non pas les habitudes, mais ma façon d'être a instauré mes manières... Faire tomber un peu de cendre à côté du cendrier... Mes archives à main droite, des bouquins devant et à gauche... Sur mon bureau une petite tête de terre, tête de mort, d'homme desséché, c'est dans le visage, les veines, les orbites, le crâne saillant, tout l'homme décalqué... Je reste souvent là à fumer. Sans rien faire. Juste là. C'est suffisant. Ça doit déjà être quelque chose, puisque si quelque chose arrive je suis dérangé. Je note sans cesse nos efforts nos besoins. Nos tensions vers nous-mêmes.
Ce n'est pas un devoir. Je dis nécessité mais rien n'est moins sûr vu l'autorité de mon orgueil.
Je fais tant d'efforts que fait l'homme, bien plus qu'il ne faudrait pour se maintenir. Rien de pire que l'espoir et l'orgueil nous mènent dans nos dernières résistances, usent de notre volonté, et abrasifs pour le corps, l'épuisent. C'est notre propre fatigue que nous produisons.
Une pièce nue soit quelques mètres. Quelques mètres pour concentrer mes efforts, aggraver mes manies... sous l'alternance des jours. Bleus. Noirs. L'orage parfois qui avance. Devant ma fenêtre. Soit.
Devant ça rectangle et moi en rond penché sur la fenêtre la table. A travailler. A pas s'en sortir sûrement à pas s'en sortir !... Dans les 28 mètres carré de carreaux de terre brute à pas s'en... à forcer comme ça pas s'en sortir. Mais il me faut cette dépense, collé au carreau de la fenêtre.
Je m'obstine je force. Je sais quelque chose. J'ai mon gargouillis ma base mon limon qui me poussent. Voilà.
Mais ça me sert à rien de penser. Plutôt écouter mes yeux mes oreilles. Me laisser aller moins de bêtises en écoutant seulement. En sentant seulement. Ici je ne pense plus et seul, moins de peurs car j'en ai eues. Des terribles plus que du plomb liquide plus que pesantes dans le corps. Les mêmes toujours vastes toujours. Arides épaisses.
Ici je suis plus silencieux. Face à la plaine je dois y être moins froid. Moins sec. Sévère mais moins froid.
Dans mes vingt-huit mètres... tout un monde... le bleu du ciel et les tournesols jaunes... au-delà...
DEBOUT AU PETIT MATIN CE JOUR-LÀ, j'étais jeune, et dehors, beau matin frais, clair comme si souvent. Les verdures pâlies par la gelée. Belles plantes plâtrées, soufflées de givre, et bientôt le ciel les couleurs le bleu du ciel au-dessus de ma colline.
Sûrement j'étais léger. Ma promenade peu de saison, les labours craquaient. L'air froid, l'air froid comme l'air brûlant qui m'ont tant appris. Le calme les épaules voûtées, et marcher dans la bise le froid, les labours craquant, les poumons piqués. Et marcher.
Marcher quatre ou cinq heures. Des chemins raides et rudes. Des traces de bêtes dans la gelée avant de disparaître avec le matin qui disparaît. L'accointance avec les bêtes, les formes simples de conscience, avec la terre, forme simple de racine.
Voici traversant tout le jour et les suivants à venir, élargissant peu à peu les cercles autour de ma cabane, et descendant dans ceux concentriques de ma chair et charpente.
Après un temps où mes explorations me menaient toujours plus loin, j'ai peu à peu rétréci mes parcours, mes marches, et puis je ne suis pas sorti plus loin que devant la maison. Et sans doute à la fin je suis resté sur ma chaise, puis sur le lit finalement. Ayant fait mon chemin.
Mais debout au petit matin ce jour-là, j'avançais rudement. Je dépassais les derniers champs... Debout, courbé et plein de silence... sans rien à dire. Sans rien. Plus rien dans ma besace. Pas tant tête creuse que sceptique. Plus rien valable à dire puisque rien n'a plus de valeur qu'autre.
Terrible je dis que de tout voir relatif et par tous les points de vue. Ne plus croire et tout juger pareillement. Tout se vaut, rien n'est plus mauvais qu'autre, et par là tout est au même tabac ridicule et absurde.
Rien que la description froide et mélancolique... Rien que la description technique de nos personnalités, mœurs et fondations profondes...
Façon de planter sa vue au-dedans, dans la matière et le palpable...
Façon d'appréhender nos profonds où c'est encore grossier, fangeux, terrestre... communément et mêlés, la hargne, la création et la tendresse. Et par d'ssus ça l'intelligence, mais intelligence à notre mesure, qui ne peut nous dépasser, qui ne peut voir largement, globalement et clairement. Sa source est en nous et ne peut se jeter qu'en nous.
Je n'ai que peu d'intelligence, mais de l'instinct et du sens pratique, de la volonté et de l'entêtement. Ils me servent sûrement pour creuser.
Dans mes vingt-huit mètres, je suis aux aguets... l'instinct restant pour moi le plus haut indice.
Jeune ? Mon âge ? Je ne sais pas. Sûr que j'étais jeune, mais allure de vieux marcheur. Je veux dire les rythmes de marche déjà inculqués. L'effort tendu toujours. Crispation des paupières, peu de repos.
Et quand je ne marchais pas, et quand je ne travaillais pas, je chauffais mes vieux os dans les rayons de l'hiver jaune passant les vitres et la poussière. Les acariens et les bourres de déchets flottant autour de moi, montant descendant clignotant dans l'air chaud.
J'entendais la cloche sonner au loin, bourdonner l'intérieur du pilier, le bois du clocher. Je sentais nettement les ondes arriver par-dessus les bancs de brume, les chassant les repoussant par de grosses vagues d'air, des masses se creusant et s'enflant, et filant ondoyantes au bout de la commune, filant dans les champs et s'engloutissant dans le feutre des forêts.
Marchais donc... Et marchais pesamment sous la pluie. Les branches me lâchaient leurs paquets d'eau froide. Les feuilles d'automne pourries dans un mélange, un sorbet de boue.
Et puis voilà, mes vieux os tout tremblants de sueur, je grelottai, le visage baigné dans la fièvre. Mes tempes suintaient le long de mes mèches. Je restais roulé dans ma couverture sous le rayon jaune, rampe de lum qui me chauffe à peine. Le bac savonneux, mon rasoir, l'eau sale, où les lentilles d'huile écument dans la tranche de lumière qui raye ma chambre comme un diamant le verre.
Je me lave dans mon lit, il sent le vieux savon de Marseille, l'écume grasse du savon séché, et la sueur qui infecte tout, mes draps empesés, lourds, graisseux, jaunes.
Je travaille dans mon lit. Mais avec la fièvre et mes maux de tête, la mousse sur le bord de mes lèvres, j'ai du mal à tenter un travail sans être vissé par l'étau qui serre mes mâchoires et mes tempes. Je parviens à l'oublier dans l'absorption et la concentration, mais cette grosse poigne revient, me presse les os de la face, et me renvois au bord du ring.
Alors, croyant sentir la manifestation physique, tangible, de la détermination, de la tension, je m'entêtais d'avantage. On ne force pas autrement les animaux libres. Mais ici, c'est à lui-même, et il est le seul à se l'administrer, que l'homme s'inflige ce traitement de cheval. Avec l'espoir et l'orgueil, la volonté est notre dernier moteur.
Je marchais tous mes après-midi jusqu'à l'exténuation et, las, tous les trois ou quatre mois, mon corps cédait. Je rompais la fréquence des expéditions et me carapatait paresseux.
Sur mes collines traversées par la bise, je trouvais là tout le silence nécessaire pour adresser mes remontées de profondeur. Je travaillais simplement, sourd en quelque sorte, à l'intérieur de quelque chose qui n'était pas moi seulement, mais un nid de concentration, un oubli du corps qui se sent. Dans ces moments là je me sentais bien, mais je ne crois pas que je sentais quelque chose. Je coulais dans mon délire, dans le monde que je forgeais, mais monde en deçà de moi, en deçà et indépendant des réseaux de sensations de son corps producteur.
Ça se faisait comme sans moi.
Etais-je pour autant encore responsable ? Je ne parlais plus qu'à peine ma langue. Je ne savais plus faire. Ce n'était pas du tout ma faute.
Je recherchais l'informulé, les combinatoires. Certainement ça m'épuisait. Certainement il fallait que je sois épuisé pour me tenir hors de moi attentif et détaché, pour chercher pour saisir... pour au-delà de moi nous voir tous et tout.
Je pourrais m'arrêter là. En lisière... si encore je maîtrisais... mais c'est échappé depuis belle lurette... le moi se décompose dans la recherche, et sa destination, son objet, semblent être le silence...
Je soutenais une exigence tarée !
Rien d'autre à faire ce matin que d'être encore ce bipède fouleur d'herbe mouillant ses ancres dans le vent !... Mais à descendre, la fatigue, l'épuisement, l'exigence, l'effort... et tous les mois, las, épuisé, mon corps tombe, me lâche. Il a peur, refuse, il craint dehors, recule. Je ne voudrais plus que rechercher, m'enfoncer encore. Mais il faudrait qu'il y ait silence. Silence autour de moi. Parler au silence. Comme seul destinataire.
Voilà. La chose est faite. Finie. Misérable miracle.
Oui je trouve ça pas grand chose. Peine, peu, mais raison de vivre. L'espace froid oui les oiseaux blancs oui les cèdres bleus autour de ma cabane oui mais autour dans le fond ce que je trouve... des autres du reste de tout sur la terre ?...
Sans doute nous sommes lisibles, visibles, transparents, tous hommes à caractères un tant soit peu lisibles. Mais descriptibles un tant soit peu est-ce possible ?
Oui je trouve ça partant de moi, mais ce n'est pas de moi que je parle, mais d'un autre cherchant, enfoui en moi.
Oui je trouve ça peu ce que je sais. De moins en moins. De plus en plus prudent.
Mais je suis calme rassuré d'avoir un cap, et qui est moi, de moi, même se dissolvant. C'est une voix, ma voie, ma pâte.
Sur ma montagne, dans les rochers, crapahutant grimpant, c'est ma voix, dans la neige dans les prises les parois dans le froid à continuer pourquoi donc continuer
On ne peut que aller.
On ne peut que... et pas possibilité autrement. Que glisser fluer. Pris dans la valse et pente, poussé vers la nuit, écrasé peu à peu vers la nuit. Et ce silence. Soudain.
JE RECROQUEVILLE dans mon trou moi plus bas je sais ce que je veux la paix me débiner foutre le camp et descendre seul planquer mes cruautés à l'ombre au frais travailler plus bas qu'on me foute la paix bien seul et bien terrible
Depuis des années, un peu plus doux, à peine audible, au fond. Toujours un peu plus nu, à peine audible...
Sur mon bidule. Bord de falaise. Je vois bien.
Je nous vois ronde le ciel avec les étoiles avec
Nous. Fleurs. Bêtes.
En bas
La sphère de terre cuite et bleue. Cobalt.
|